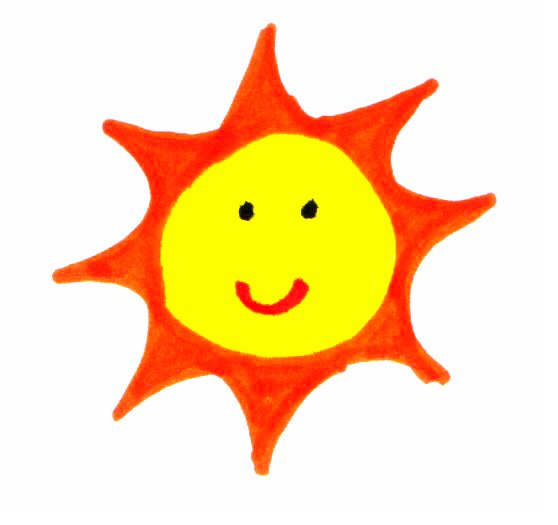L’arrivée
Premières visions. Je ne peux me résoudre à utiliser un singulier. L’Inde est un tout. Pleine de murmures et de cris déchirants, d’immenses terrains inhabités et de villes surpeuplées. Un paradoxe. Surtout. Visions de nouveauté, de climat, d’odeurs, de moeurs, de pauvreté. Horreurs ? Surprises, plutôt. Les réactions s’enchaînent, s’entrechoquent, se confrontent. Je perds pied. Hésitation entre ouvrir grand les yeux pour ne rien manquer du spectacle ou les fermer pour éviter de m’y laisser changer, noyée. Laissez-moi vous raconter.
Je suis arrivée à l’aéroport Sahar de Bombay le 24 mai 1997 aux environs de une heure du matin. Il y a à peine une trentaine d’heures, je quittais Montréal, en compagnie d’Amélie, pour m’envoler vers une grande aventure. Grande à quel point ? Je n’aurais su le dire. J’étais prête à tout essayer ce qu’on me proposerait de vivre. Je voulais tout. Vivre, surtout.
Le jour du départ, il fait gris et froid à Montréal. Je respire mal, je suis au point de non-retour. Moi, Geneviève D., confrontée à elle-même pour la première fois. Réussirai-je ? Ma mère me parle comme si c’était la dernière fois. Je fonce. Et vlan pour les conformistes ! Je risque et je gagne. But insouciant, but accompli.
À la sortie de l’avion, une chaleur étouffante nous pénètre les pores, insinuante. Insistance des grands fantômes, omniprésents par la force des choses, mais oubliés dans les dédales du temps. Constraste avec ce que nous avons quitté. Premier choc. Nous nous frayons un chemin parmi la foule garnie de dames aux saris défraîchis et de soldats de l’armée baragouinant un charabia assonant. Il y a des déchets, l’atmosphère me semble mauvaise, des corneilles indiennes volent au-dessus de nos bagages, les moustiques nous piquent. J’ai l’impression d’être dans un film. Fatiguée. Apeurée, surtout. Des hommes nous pointent du doigt. Rient. Grivoiseries en hindi. Exotisme déplacé. Je déchante un peu. On m’avait prévenue. Bombay, la terrifiante. Bombay, la terrible.
Nous décidons de nous trouver un hôtel. Il faut réserver. Je m’habitue peu à peu à cet accent inimaginable. Rien dans nos prix. Quelque chose à tout prix ! Nous trouvons. Bagages en dos, Lonely Planet en main, me voilà à l’extérieur. Seule avec moi-même, malgré la présence rassurante d’Amé. Lonely Planet... Nous rendre à destination. Premier contact avec l’indien moyen : le chauffeur de taxi, expert de l’escroquerie de touristes qui n’ont assez de leurs yeux pour tout absorber, ou plutôt, roi du bargain. Les parlementeries sont de courte durée, profanes que nous sommes, avides d’une douche et d’un lit... Défaites ? Note mentale : "Gen, on apprend de nos erreurs, mais apprends vite!"
Premières constatations du monde environnant. Une ville de 15 millions d’habitants. Autant de lumières qu’à Palmarolle, P.Q., village fleuri de ma jeunesse ne comptant que 1500 âmes grisonnantes et une dizaine de lampadères. Le taxi roule à quelques 140 kilomètres/heure. Le coffre arrière ne ferme pas bien. J’ai peur que nos bagages s’envolent. Je délire. Ils font plus que l’indien moyen. Hésitation entre respirer à fond le parfum d’aventure s’annonçant épique ou fermer le nez parce que, finalement, ça pue terriblement.
Maisons de bois, maisons de pierre, clochers pointus. Et dans les fonds des pâturages de silence, des enfants blonds nourris d’azur comme les anges, jouent à la guerre imaginaire...
Défilent sous nos yeux des logis, taudis serait plus juste, faits de boîtes de carton portant l’emblème de compagnies prospères. Américaines. Pas d’adresses, que de petits empilements, anarchiques dans leur construction, constructifs dans leur anarchie. Décors de théâtres vides, à quatre roupies cinquante... Sans âme. Les premières ne sont pas loin. Couchées en plein fossé, à moitié nues. Le cheveu hirsute, couvertes de crasse, humide et chaude. Traumatisme. Tableau complet : odeur de cadavre en putréfaction avancée, mort d’une diarrhée carabinée accompagnée de vomissements, voiture contenant deux princesses américaines, grandes, bâties, les joues roses, filant à vive allure parmi la populace sale, terne, apeurante, pauvre, parsemant le pavé de sa carcasse endormie, épuisée, fuyant la réalité, dure. Trop. Final touch de pro : le chauffeur ignore où se trouve l’hôtel, s’arrête dans un coin mal famé et laisse les deux princesses américaines pour aller demander son chemin. Un silence inquiétant, un sentiment d’être épiée. Obscurité. Seul éclairage sur le paroxysme de la pièce : un homme traversant la pseudo rue à quatre pattes, rongé par la polyo. Il est deux heures trente, le coeur battant, suintante. J’ai mal au corps, au nez, aux yeux. Je pense à tout ce que j’ai quitté. Tout ce que je viens de découvrir. Hésitation du coeur entre aller voir plus loin ou retourner chez soi. La princesse américaine retrousse ses manches, décide de ne pas se plaindre, paie le taxi et prend l’ascenseur lui chantant des tounes de Noël alors qu’elle se dirige vers un repos bien mérité, sûre d’avoir la malaria, témoins les dizaines de piqûres lui démangeant le bras.
Le lendemain, Bombay,45 degrés à l’ombre de l’été, une fille en train de tomber, immensité d’un pays sous-développé...
" Il y a des singes dans l’arbre !" Et un oiseau au cri (le chant n’implique pas de variations sur le thème de la fausse note perpétuelle) désagréablement constant. Après une nuit réparatrice de deux heures, une douche-seau à gouttelettes rarissimes et après s’être faites avoir la veille (pour ne pas dire dans un langage plus cru, "fourrer d’aplomb") par le chauffeur de taxi, moi et Amélie décidons d’affronter Bombay à pied. Pour la néophyte, cela implique exotisme, un peu de sueur et beaucoup d’excitations et de découvertes. Pour celle qui sait maintenant de quoi elle parle, cela implique marcher deux heures de temps avec un 85 litres plein à craquer sur le dos, une gourde qui manque de l’étouffer à chaque mouvement de bras trop audacieux, un murmure incessant sur son passage (les "Yes, PLEASE" , "What do you want ?" , "Look, nice , same, same, different, different"), en manquant de s’enfarger dans les craques de trottoir (littéralement défoncées) car elle tente d’éviter le rat mort-écrapou gisant dans son jus dernier aux ragoûtantes déclinaisons de brun, arborant désolemment sa sandale ALDO ("Tu peux affronter n’importe quoi, chère, avec ça" avait dit la vendeuse du mois de la succursale de St-Hyath.) et, pour terminer cette énumération qui ne se peut plus d’elle-même, tout cela dans la MAUVAISE direction. J’étais abattue, découragée. Je n’avais jamais, mais alors là JAMAIS eu autant chaud de toute ma vie. Peu mouvementée. Jusque-là. Moi et Amé commencions à parler de la maison, à tout comparer ou simplement à garder le silence. Silence, qui dans mon cas se voulait de résignation. Note mentale : "Gen, t’es là pour deux mois et demi, fais-toi à l’idée ! Et fais-toi la au plus vite !" Ambivalence. Hésitation entre hurler maman-viens-chercher-ta-fille ou faire la grande fifille devant ce monde qui la prend pour un guichet de la Banque Nationale un vendredi 24 décembre au soir, avant de sortir au Ritz pour le réveillon..
Les regards. Rarement curieux. Mendiants, surtout. Horreur devant enfants, beaux comme des anges, vêtus de haillons, un bras manquant. Horreur devant vieillards, nus ou presque, la dent pourrie, le regard éteint. Quêtant. Sans cesse. Vénérant le dieu blanc pour l’argent lui permettant, peut-être pour la première fois de la semaine, de se mettre un chapatti sous la dent . Le haïssant pour ce qu’il représente : le succès, l’intolérance, l’ambition à outrance, l’égoïsme, le Pepsi et ses boîtes de carton. La condescendance, envers et contre tout. L’indifférence, surtout. Que puis-je faire, moi, Geneviève D., devant ce 15 millions d’habitants hurlant leur rage de vivre en me demandant sans cesse à moi, Geneviève D., blanche minorité visible, un centime pour leur subsistance ? Impuissance. Déception. Down the drain, les idéaux... Au caniveau, la lubie du god complex. Note mentale : "Gen, fais ce que tu peux, même si ce n’était que de te changer toi, ta façon de penser. Aide dans la mesure de TON possible. Pas celui de mère Teresa ou du Cardinal Léger.T’es pas le bon dieu. Rends-toi en compte! Mais surtout, rends-toi en compte le plus vite possible"
Urgences. De se sentir à sa place. De se sentir bien. De sentir que ça pourrait être bien. Que ça sera bien. Deuxième choc.
Arrivée à destination, Victoria Station., VT, pour les intimes. Si belle de l’extérieur. Grande, rassurante. Propre. Surtout. Intérieur surprenant : pancartes plein les murs affichant une propagande qui me semble une blague de bien mauvais goût. "Ne crachez pas par terre sous peine d’amende" et "Il est formellement et strictement interdit de pisser le long des murs" Je n’ai plus assez d’orbites pour contenir mes yeux ou de narines pour respirer à travers les odeurs émanant de la propagande non respectée. Non-respect. Respect. Hésitation entre amplifier l’absence totale de l’un ou la montée flagrante de l’autre. Le sol grouille de monde attendant le prochain train, arrivant douze heures plus tard. Courses incessantes. Entre les directions de l’un, les indications de l’autre. L’indien moyen sait toujours de quoi il parle, surtout quand il n’en a pas la moindre idée. Deux heures trente plus tard, billets en main, départ assuré, rassurant. Chambre avec air climatisé. Dormir. Se réveiller ailleurs. Larmes. De peur. De désespoir. De solitude. Accablantes, comme une tache de sang sur un mouchoir. La princesse américaine n’est pas aussi forte qu’elle le pensait.Honte. De se laisser aller, d’admettre sa vulnérabilité à l’autre, à eux, mais surtout à soi. Regrets. Maman, papa, eau courante. Note de carnet de bord, 24 mai 1997 : "It’s us both against India, against the world, THEIR world." Bangalore! Me réveiller demain et voir tout sous un nouveau jour. Bangalore ! Plaintes d’une princesse loin de sa cabane au Canada, de son kitsch quotidien, connu, accepté. Sentiment d’oppression. Devoir de se défendre contre l’envahisseur. Combat inégal. Se plier tout de suite. Rendre les armes. Cesser de tout comparer. Vivre. Tout vivre. Accepter de tout vivre. Troisième et dernier choc.
Bangalore : la réconciliation
Quelques
vingt-quatre heures plus tard, le cheveu en bataille, le corps un peu meurtri
par le tangage du train, j’arrive à Bangalore. Une indienne fort
sympathique nous indique où nous rendre et quoi demander. Il fait
beau. Dans ma tête, dans mon corps, dehors. Sentiment généralisé
de bien-être. Oubli du mauvais rêve. Pas de chaleur étouffante.
Le murmure incessant se fait plus discret. Dernier rendez-vous avec la
chance : appel au dispensaire. Sommes-nous attendues ? Oui. Nous avons
droit à un accueil chaleureux. Sr Kani, notre contact, est là,
le sourire rassurant, le rire facile. Sr Pauline, un peu plus austère,
mais le regard doux, amical. Un accent compréhensible, un ton de
voix chantant, sans requête dissimulée. Acceptées,
les princesses américaines. En faire des princesses indiennes !
À tout prix. Le plus vite possible. Fleurs autour du cou, parts
de gâteau. Un endroit pour nous reposer au dispensaire avant d’aller
rencontrer la famille qui nous attend, notre famille. On semble nous comprendre,
ou peut-être cette marque de civisme me touche. Humilité devant
la vie. Honte d’avoir douté de sa beauté. Hésitation
entre hurler de joie ou pleurer de soulagement. Syntonisation sur le pôle
aventure. La brume disparaît sous la promesse de jours nouveaux et
heureux.
II. L’odeur du peroxyde
La vie de famille
Le village que j’habite est petit, pauvre, mais s’en sortant bien malgré tout. Ce tout englobant un gouvernement corrompu, un peuple affaibli par les nombreuses conquêtes, un manque d’éducation et une ferveur religieuse menant parfois à un fanatisme et une obsession rétrograde ou, du moins, amenant à une stagnation ethnocentrique. Notre maison est modeste, mais confortable. Appa est jardinier pour le presbytère et Amma fait la cuisine et s’occupe de la maison. Ils nous ont installées dans une chambre, où nous dormons, Amé et moi, dans le même lit. Mal serait pris de me plaindre car le reste de la famille (Appa et Amma, Rani, LurthuMary, Mary, (les filles ) Arul et Anthony, (les fils de la famille) dorment dans la pièce d’à côté. La plus jeune de la famille a 15 ans.Ce ne sont donc que des adultes qui s’entassent pour nous. Ils sont gentils, avenants. Prudents ? Trop, peut-être. Les premiers jours sont passés à faire connaissance. Honte. Reconnaissance. Déjà, à ce moment, je sens que je ne réussirai que difficilement à faire oublier ma couleur de peau et mon statut de richissime blanchâtre cultivée, ne parlant pas kannada (ni telugu ni tamil ni malyalam ni hindi). Tache à mon curriculum. Honte de ne pas savoir. Se sentir obligée de savoir.
En écrivant ces lignes, j’ai l’impression d’être passée à côté de quelque chose. D’une autre façon, je me rends compte que la vie de la famille se limitait à bien peu de choses : les repas, où l’on n’osait nous inviter et où, si nous avions pris l’initiative, la famille se serait sentie obligée de faire un banquet lui coûtant les yeux de la tête. J’ai été confrontée à la réalité des femmes indiennes d’une famille comme la mienne : faire les repas, avoir des enfants, s’occuper des enfants. Peu d’éducation, un mariage arrangé, une soumission au mari et, par procuration, à la belle-famille. Le devoir de produire des garçons, la valorisation par l’apparence. J’aurais voulu faire partie de ce cercle, pour pouvoir dire que j’en étais revenue. On a beau créer sa propre chance, être choyé par la vie ça se constate dans ces moments-là. C’est difficile de s’en départir ou de faire oublier aux autres d’où l’on vient, surtout lorsque ce lieu est idéalisé dans les yeux d’un peuple entier. J’aurais aimé pouvoir dire que j’ai dormi par terre avec eux. Non. Que j’ai passé le plus clair de mon temps avec eux. Non. Qu’ils m’ont toujours fascinée et que je n’ai jamais perdu patience envers eux, consciemment ou non. Non. Note mentale : "Gen, c’est l’intention qui compte.(Voix off : bullshit de romans Harlequin !) Si tu crois ne pas avoir assez essayé alors lapide-toi et vite, mais sinon, apprécie les limites interrelationnelles, apprécie tes limites. Accepte-les et vite !" Toujours cette urgence de vivre à fond, d’avoir tout vu. Je réalise maintenant que mes attentes étaient impossibles. Pas en deux mois et demi. Peut-être jamais dans toute une vie.
La bouffe nous est servie en quantités industrielles et s’avère une épreuve à franchir au début de notre séjour. Le visiteur en Inde se doit d’être bien nourri, logé et ne doit pas avoir à s’atteler aux tâches ménagères quotidiennes. En visite pour deux mois et demi. Devant faire oublier ce qu’elle représente. User de ruses pour pouvoir faire sa vaisselle. Toute proposition d’aide se voit refusée. "You’re not used to do this. You have servants at home." Outrage. Malédiction. Se battre contre une ombre que l’on ne connaît pas. Difficile de savoir ce que je représente aux yeux de la famille chez qui j’habite et qui m’invite au mariage d’un des leurs, alors que je dois m’asseoir sur une chaise tandis que tout le monde est accroupi sur le sol. Protestations. De parts et d’autres. Surtout de la mienne. La première fois, je plie. La deuxième, je refuse et vais m’asseoir avec LurthuMary et Rani. Je me sens mieux. Le message est passé. Mais quel message au juste ? Difficile de communiquer quand les premiers intants de nouveauté sont passés et que la english madam fait répéter plus de deux fois et n’avance pas super vite. Cinquante et une nouvelles lettres, d’un script différent, d’une sonorité martienne... Apprendre. À tout prix. Le plus vite possible. Accepter de ne peut-être jamais pouvoir réussir.
Au début du séjour, je me voulais de tout essayer. Dire oui, tout le temps. J’avais peur de décevoir ou de passer pour ingrate. J’ai donc dit oui, pendant deux semaines complètes, à tout ce qu’on me présentait : bouffe atrocement épicée pour mes papilles gustatives encore vierges, déguisement en indienne typique, tour de chaque maison, re-bouffe, longues soirées à suivre la famille dans ses promenades, acte de présence à deux messes en kannada dans la même semaine, re-bouffe de sambhar et de sapotas, tour de tempo... Epuisement, mal du pays, mal, tout court. Reprendre son stage en main. Il me faut apprendre à dire non aux choses qui me dégoûtent littéralement et refuser une deuxième portion de ce qui ne le fait que partiellement. Essayer de faire comprendre à ma famille que l’eau qu’il me donne à boire me rend malade et m’a même greyée d’un ami : Biase. J’essaie de ne pas me sentir coupable de ne pas tout aimer, de bitcher de temps à autre sur l’illogisme ou l’irrégularité de certaines pratiques douteuses, de m’ennuyer de chez nous. Même aujourd’hui, je trouve ça difficile. La peur de la princesse américaine : en être une, en devenir une, en avoir été une...
La vie au village
Les premiers temps, les gens au village nous observent, nous épient. Par curiosité. Je suis une des rares blanches qu’ils aient vu de près. Ils s’approchent, me demande mon nom, d’où je viens. Je réponds en kannada, les gens sont heureux de cet effort, mais s’impatiente rapidement de devoir me répéter ce qu’ils viennent de dire ou encore devant ma totale incapacité à comprendre quoi que ce soit. Je passe pour débile. Je supporte. Tant pis, j’aurai essayé.
Les enfants sont adorables. Ils connaissent autant d’anglais que moi, de kannada. Ils courent pour nous serrer la main, nous embrasser ou nous dire tout ce qu’ils savent d’anglais dans la même phrase. Ils sont curieux, simplement. Trop jeunes pour juger. Nous avons même notre fan club qui connaît tout de nos allées et venues à travers le village et sort au moment où nous le traversons. C’est un tohu-bohu de rires, de charabias, d’excitations. J’en prendrais des dizaines avec moi. Les plus vieux qui vont à l’école nous font des tatas, lors de la récréation. Deux cents petites mains qui s’agitent, un sourire aux lèvres, ça fait chaud au coeur. Je me suis sentie chez moi. Un peu. Egale. Enfin.
La première tranche de vie anecdotique - Vers la fin de notre stage, un beau matin, nous avons essayé de mettre nos saris pour nous rendre à la clinique. Quelle ne fut pas ma surprise de voir surgir une indienne de nulle part nous disant qu’ils n’étaient pas mis de la bonne façon et, sur ce, de nous déshabiller en plein milieu du village pour remédier à la situation. Le résultat final était, ma foi, fort semblable à celui de départ, mais tellement plus nice aux yeux de cette dame... Elle semblait très excitée du fait que nous soyions habillées comme elle, décemment, c’était comme lui dire : nous voulons vous ressembler... Elle avait participé à l’indiennisation de deux english madams, heureuses et fières de leur accoutrement.
Le quotidien : allées et venues dans un monde où le plus beau reste à faire
Aléas et tranches de vie s’entrechoquent au moment où j’écris ces lignes. Pourtant, mais, aussi. Je me relis et vois ressortir de ce mémoire un parfum doux-amer auquel je ne m’étais pas attendu. Au contraire. Plutôt. À éviter. Me cacher de la remise en question. À plus tard. Le plus jamais, le mieux. Désinfecter tout. Mes souvenirs, leur interprétation. Le recul m’a-t-il fait déchanter? Mon rêve indien n’était-il que cela ? Un rêve. Delirium tremens. Foutaises ! Non. Je m’objecte. Je ne suis pas complètement folle. Des sentiments. LE sentiment. D’avoir accompli quelque chose tout en étant inutile, d’avoir donné tout en recevant tellement, d’avoir aimé tout en méprisant les diktats de base, d’avoir compris tout en demeurant complètement mystifiée. Quatrième et dernier choc. Le plus fort, le plus insistant. Celui ou il ne reste plus que le trio infernal : me, myself and I ... Une vie complète à se demander. Si... Pêle-mêle. Mélange hétéroclite d’odeurs, de sons. Ahhhhh! Si la mémoire pouvait transmettre en trois dimensions... Laissez-moi essayer.
Je visitais une école d’un petit village. Les habitants, fiers d’avoir des étrangères dans leur bled de poussière. Les enfants. Charmants. Toujours. Un peu timides. Ayant peur de déranger les grandes personnes. M’approcher d’eux. Les prendre en photo. Les faire rire. Joie immense. Déjà que j’adore les enfants. Note mentale : "Gen, tu veux avoir des enfants et vite ! (Voix off : Wo-là, ça fera le Harlequin, il faut d’abord trouver un mari ! )" À l’intérieur de l’école, une bibliothèque. Proprette, bien entretenue. Bricolages, livres d’histoire, lettres de l’alphabet. Cinq sur cinq. Tout semble dans les règles. Tout ? Un pot à contenu douteux arrête mon coup d’oeil. À première vue, le contenu repose dans son dernier jus : le formol. Surprise. Un battement de coeur en moins, une parcelle de nausée en plus. Gisant dans son jus dernier ? Un bébé. Singe ? J’aurais préféré. Un bébé. Tout ce qu’il y a de plus humain. Toublée, perplexe. Ma réaction attire l’attention de Rani qui tente de m’expliquer que ce n’est que pour les travaux pratiques et de me demander si l’on en fait à la maison . Oui, oui. Rapides. Sujet clos. Angoisses. Un bébé ? Fille.
Je me promenais dans une ville portuaire (à la fin de mon séjour, en voyage) et je passe devant une petite école de filles sise à côté d’une église dont je veux épier l’intérieur. L’air est tiède. Un vent marin, les narines salées. Un serrement à l’idée que le séjour achève. Poursuite à peine gagnée contre des adolescents rêvant de chair. Blanche. Inévitablement offerte. Je pénètre dans la cour et entreprends de la traverser. À notre vue, les petites filles se ruent à l’extrémité de la cour. Note mentale : Gen, si c’est rendu que tu fais peur aux enfants, mets-toi un sac sur la tête et vite ! Surprise. Elles reviennent en courant. Vers nous. Des fleurs à la main. Elles nous embrassent et nous offrent leur trésor. Saignement de coeur. Honte d’avoir douté. Rendre les caresses. Les prendre en photo, fières. Fière.
Prendre l’autobus. Se frayer un chemin parmi les trois cents Autres, de sueur vêtus. Voir une vieille dame pousser une femme enceinte jusqu’aux yeux pour pouvoir être assise à sa place. La rattraper, l’aider. Lui céder le passage. Les hommes. Vulgaires. Ne cédant jamais leur place. Regards inquisiteurs. Condamnant la facile blanche qui ose s’asseoir à leur place, à leurs côtés. Voleuse de mari ? One of the guys. Ça ne se fait pas. Ça frôle l’indécence. Le sourire dur. L’oeil inquiet. Résignée.
Foule. Deux cent dix personnes pour une capacité maximale de soixante. Obligée d’être debout, 40 litres plein à craquer, papi crachotant en train de me trucider de sa canne en bambou. Regardant autour, toujours, Amé est ok. Je suis ok. Note mentale : Gen, on est 500 dans l’autobus, zéro sur le bord de la rue, on avait de la misère à se tiendre ! (Voix off : Ben, non ! Cool ! Etre penchée en arrière à un angle de 60 degrés... Tu tiens toute seule, plains-toi pas !) Développer une agressivité de foule. Jouer du coude avec la mamie hargneuse qui nous balance son panier de provisions à la tête. Courir pour avoir une place. Folie furieuse. Pathologique. De société. Je suis indienne.
III. Le corps humain, ce terrain
de jeu incroyable.
Jeu ? Oui. De la vie. De l’ignorance qui blesse les innocents. Qui amplifie le mal. Qu’on ne peut pas condamner. Jeu de découvertes. De la Vie. Maternités. Conditions de vie. Sutures qui tiennent le coup.
Présentation des personnages : Moi, Geneviève D., blanche pré-med innocente ayant un background clinique à peu près nul, Sr Pauline, gynéco-obstétricienne, maître reiki et omni hors pair, Sr Kani, sage-femme, infirmière et rural practitioner, un coeur grand comme le monde et des étoiles dans les yeux. Sr Rosemary, un peu bébête, sans recul devant la vie, une pratique infirmière douteuse et Sr Lydia, un air de boeuf, des manières rudes, un tendre bulldog. Avec le recul, les anecdotes affusent, mêlées, un peu. Peut-être que tout s’est passé la même journée. Un million de souvenirs en 60 secondes. Imaginez deux mois et demi... Imaginez.
La petite fille de la motocyclette
C’était vers le milieu du mois de juin. Le choc culturel, passé depuis longtemps. Enfin, c’est ce que je croyais. La matinée au dispensaire semblait tranquille. La saison chaude achevait et avec la saison des pluies, commençait les pseudo-pneumonies et autres rhumes de minus propres aux changements de saison. Surtout pour un peuple, indien. Injections ? Yes, injections. À tort et à travers. Surtout, non-stériles. Ça fait sortir le méchant plus vite. La routine, donc. Tout à coup, arrive un Jean-Guy à moustache de 80 livres tenant dans ses bras un petit paquet de 40 livres. Une petite fille de 4 ans. La tête fendue. On voit le crâne. Hurlements sourds, plaintifs. Ignorance du père. Intolérance grandissante envers ces idiots qui se promènent à 6 sur un scooter. Pas de casques. Pas de limites de vitesse. Pas d’asphalte. Une grosse roche. La moto fait un bump. La petite fille tombe... Sur la roche. Nous sommes cinq pour la tenir alors que Sr Rosemary tente, de sa main de twit malhabile, de recoudre le cuir chevelu. Pas d’anesthésiques. Ils ne sont pas assez bien pour réaliser le traitement. Protestations de ma part. Note mentale : Gen, maudit kannada ! Je ne comprends pas. On ne la gèle pas ? Si, c’est l’argent, je me propose de payer. Dégoûtée. Non, ce n’est pas une question d’argent, mais plutôt de ressources. Nuance. On n’a pas d’anesthésiques. Hurlements de douleur d’une petite fille outrée. La vie lui rentre dedans. Elle s’en souviendra. Je pleure. Je suis en train de participer à un geste médical, mais je pleure. Bouleversée. J’ai la nausée. Je me concentre sur la rigueur de ma position. Surtout qu’elle ne bouge pas. Lui éviter de la douleur. Six points plus tard, c’est fini. Elle se blottit contre l’auteur de son malheur. À défaut de mieux. Fini ? Non. On réalise que le coin de son oeil est sanguinolent et qu’un lambeau de chair pend. La comissure externe de l’oeil. Rapprocher les deux morceaux sans aveugler un être innocent. Je frapperais tout le monde. Même requête. Vous êtes sûres qu’il n’y a pas d’anesthésiques? Variations sur le même thème : non. À froid. Le coin de l’oeil est recousu. Hurlements redoublés. Je me sens chanceler. De rage. Je tente de faire abstraction de ce qui m’entoure. Quatre points plus tard, tout est fini. Jusqu’à la prochaine fois. Sans casque. Ni limite de vitesse. Encore moins d’asphalte. Je sors en courant de la salle. De l’air ! À mon retour, Sr Rosemary rit. Je n’ai pas l’habitude du sang selon elle. S’habitue-t-on jamais à voir une enfant souffrir par la bêtise humaine ? Non. À moins d’être idiot. Ou mort. Dans l’âme.
Les grains de café
Un matin semblable au précédent. En plus humide et étouffant. Une mère tient dans ses bras un magnifique bébé d’environ 10 mois. Il pleure. On note un pansement à sa main. Une fois retiré : horreur. La paume entière est déchirée. Le pauvre est tombé sur une roche il y a, mon sang fait trois tours, trois jours. La plaie est recouverte d’une substance brunâtre, en grains. Du café ! Imaginez la douleur de l’enfant. Sr Pauline de me dire que c’est une coutume, à condamner certes, mais une coutume fort répandue dans les villages. Ignorance des villageois. Incrédulité de ma part. Souffrance des deux côtés. Qui auraient pu être évitées. Par l’éducation. Par le gros bons sens.
La vie comme seule issue
Après plusieurs entrées en matière. L’heure des grands tourments a sonné. Je suis dans la salle d’accouchement. Sr Kani me dit : "Veux-tu accoucher cette dame ?" Note mentale : Gen, ayoye ! La peur au ventre, le tremblotis dans les jambes, mais le feu au coeur. Affirmatif ! Je dois faire l’examen périvaginal pour évaluer l’ouverture du col. Presqu’aucune idée de ce que je fais. Je suis les conseils et directives de Sr Kani. J’évalue bien, il me semble. La tête s’engage. Je soutiens le périnée sous les encouragements de Sr Kani qui me rassure de son sourire désarmant. Poussez ! Poussez ! Le bébé sort. Hurlements de vie ! Je suis émue. Conquise, plutôt. Par cette médecine de joie, de rêves à venir, de balbutiements. En douceur. Je le tiens dans mes bras, coupe le cordon, le mets sur la table à langer et lui aspire les sécrétions à l’aide d’une petite poire. J’ai l’impression que je vais lui trucider les narines. Ignorante, malhabile. Un jour, je saurai ! Plus belle journée de mon stage ? Oui. Heureuse. Un petit garçon de 2,54 kg est né. Et j’y étais. J’en étais. J’en suis ! D’avoir appris. D’avoir su être à la hauteur. Égale. Ou presque.
Trop jeune...
J’attendais avec une de ces femmes enceintes dans la salle de travail. Travail ? Cheap labor, plutôt. Il doit certes y avoir des limites à enfanter dans la douleur ! Tout semble normal. Quatre heures d’attente et toujours rien. Premier enfant, difficile enfant. Pause. On laisse la jeune fille (elle n’a même pas mon âge) et part pour la soirée. L’accouchement n’est finalement prévu que pour le lendemain. À notre retour. Elle n’est plus là. À l’hôpital général de Bangalore, elle repose entre la vie et la mort. Éclampsie toxémique. Huit séries de convulsions sur la table d’accouchement. L’enfant est en parfaite vie, la mère en imparfaite mort. Une fois de plus, ça me tue. Incompréhension. Outrage! Qui auraient pu être évités. Encore. Toujours. Pour la première fois de ma vie je me surprends à prier pour la vie de quelqu’un. Autre à moi. Autre moi. Horreur pour le bébé si la mère ne se remet pas. Vivre en Inde n’est déjà pas une sinécure... Au bout de trois jours, elle survit. Hors de danger. Sans séquelle. Un miracle. Un des premiers. Non pas le dernier. Je l’espère. De tout mon coeur.
Le retour au pays
Malade comme un chien. Trente livres en moins, un parasite et une bactérie en plus, me voilà à Toronto m’émerveillant devant le premier québécois rencontré. Une langue chantante, douce, que je comprends. Un sacre. Aucun outrage. Une joie inexplicable plutôt. Avoir hâte de rentrer chez nous. Depuis que je suis partie. Depuis que j’ai eu idée de partir. Vivre, c’est voir autre chose, mais rentrer chez soi pour en parler. J’ai hâte de revoir mes parents, mon frère. Prendre un bain. Aussitôt arrivée, je me suis sentie différente. À part. Arrogance s’il en est une. Sachant que j’ai vécu quelque chose de beau, de grand. Je ne sais toujours pas quoi. Cela se traduit peut-être par un éternel émerveillement devant la vie et sa simple complexité ? Que j’avais au départ, qui s’est exacerbé depuis. Cela se manifeste aussi par une éternelle remise en question, une évaluation de chacun des gestes que je pose. J’ose oser. Je suis insaisissable, invulnérable. Arrogance muette. Une élimination progressive de tout ce qui m’empoisonne la vie. Elle est trop belle, mais surtout trop courte pour la gâcher par de mauvais choix. Je m’impose des vérités et m’élimine des limites. Je vie rationnellement, mais avec passion. Une nuance au coin des yeux, une brume au cerveau, un baume au coeur. De rêves, je me nourris. De rêves, j’étanche ma soif. De rêves, je réalise ma vie.. Veni, vidi, vici...
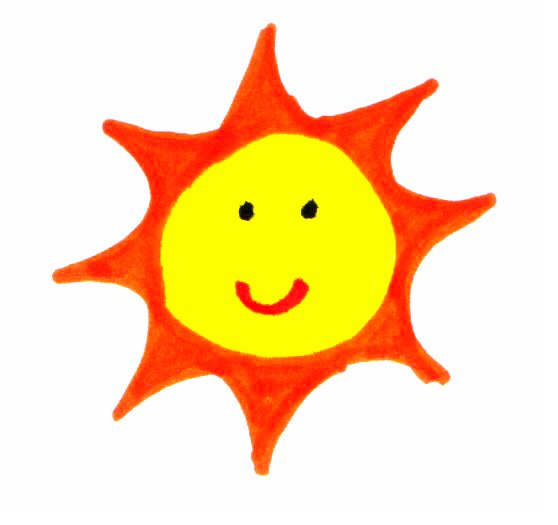 Retour à la page
d'accueil
Retour à la page
d'accueil